Liste des liens
L'ONU a lancé mercredi le processus vers un traité "historique" pour lutter contre la pollution plastique, dont les millions de tonnes de déchets menacent la biodiversité mondiale.
L'assemblée pour l'environnement de l'ONU (ANUE), plus haute instance internationale sur ces sujets réunie dans la capitale kényane Nairobi, a adopté une motion créant un "Comité intergouvernemental de négociation" chargé d'élaborer un texte "juridiquement contraignant" d'ici 2024.
"Je ne vois pas d'objections, il en est ainsi décidé", a lancé le ministre norvégien de l'Environnement Espen Barth Eide, président de l'ANUE, devant les représentants de 175 pays réunis en présence et en visioconférence.
"Aujourd'hui, nous écrivons l'Histoire. Vous pouvez être fiers", a-t-il poursuivi sous les applaudissements des délégués debout, après avoir formalisé la décision d'un coup de marteau... en plastique recyclé.
Cycle de vie
Le mandat de négociations couvre un très large spectre de sujets prenant en compte "le cycle de vie entier du plastique", de la production et de l'utilisation "durable" à la gestion des déchets, la réutilisation ou le recyclage.
Il inclut les pollutions terrestre et marine issues aussi bien des plastiques que des microplastiques, produits fabriqués à partir d'hydrocarbures fossiles et responsables selon l'OCDE de près de 3,5% des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.
Les négociations devront également porter sur la fixation d'objectifs et définir des mesures qui pourront être "contraignantes" ou "volontaires" au niveau mondial. Le traité pourra aussi prévoir des plans nationaux de lutte, tout en prenant en compte les "circonstances" spécifiques des différents pays.
Le mandat prévoit d'élaborer des mécanismes de contrôle ainsi que des financements pour les pays pauvres.
Le texte recommande en outre "d'encourager l'action de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé", dans un secteur qui pèse des milliards.
Le comité devra débuter ses travaux au second semestre 2022, après une première réunion préparatoire, avec "l'ambition d'achever ses travaux pour la fin 2024".
"Vous allez faire ce pas crucial pour renverser la vague de la pollution plastique. C'est un moment historique", avait lancé avant l'adoption Inger Andersen, directrice exécutive de l'agence de l'ONU sur l'environnement (Unep).
Il s'agit pour elle de la principale avancée depuis l'accord de Paris sur le réchauffement climatique en 2015 pour faire face à la "triple crise" qui menace le monde: changement climatique, effondrement de la biodiversité et pollution.
"Tournant de l'Histoire"
"Nous sommes à un tournant de l'Histoire, où les ambitieuses décisions prises aujourd'hui peuvent empêcher la pollution plastique de contribuer à l'effondrement de l'écosystème de notre planète", a commenté pour sa part Marco Lambertini, directeur général du WWF.
Le mandat de négociations couvre tous les chapitres voulus par les ONG environnementales. M. Lambertini a toutefois souligné que "le travail est loin d'être achevé" et que les négociations devraient déboucher sur un traité aux "normes mondiales claires et solides".
L'engagement affiché de grandes multinationales, dont certaines grandes utilisatrices d'emballages comme Coca-Cola ou Unilever, pour un traité fixant des règles communes renforce l'optimisme, même si elles ne se sont pas prononcées sur des mesures précises.
Dans un communiqué, le responsable de la recherche d'Unilever, Richard Slater, a salué une décision "historique" qui sera "un catalyseur d'innovation et représente aussi ce que veulent les consommateurs: moins de plastique".
Quelque 460 millions de tonnes de plastiques ont été produites en 2019 dans le monde, générant 353 millions de tonnes de déchets, dont moins de 10% sont actuellement recyclées et 22% sont abandonnées dans des décharges sauvages, brûlées à ciel ouvert ou rejetées dans l'environnement, selon les dernières estimations de l'OCDE.
Cette pollution contribue notamment à l'effondrement de la biodiversité, relevé par tous les spécialistes, alors même que les "solutions basées sur la nature" sont considérées dans le nouveau rapport des experts sur le climat de l'ONU (Giec), publié lundi, comme un outil important de lutte contre le changement climatique et d'atténuation de ses effets.
Maison des Comoni au Revest-les-Eaux
Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique.
 ©Hubert Amiel
©Hubert Amiel
L’Habeas Corpus Compagnie
Un homme, personnage anonyme, acrobate du quotidien, lutte avec acharnement et application pour garder l'équilibre dans un environnement mouvant qui le contraint, l'oblige et le déstabilise sans répit… Enchaînant les tâches absurdes et répétitives, il tente de rester debout malgré les éléments qui le bousculent ; le sol se dérobe, autour de lui tout glisse, chute, fuit, le malmène. Il est de celles et ceux devenus pantins, piégés dans l'engrenage du travail, du rendement économique, de la surconsommation maladive, de la pression ordinaire.
Ici, le cirque témoigne d'une réalité brûlante. Une performance émotionnelle, bouleversante de vérité et de poésie.
Les textes, fragments de témoignages et de documents, percutent. Les images, graphiques, symboliques, portent un sens radical. Le plateau qui s'élève en une pente abrupte (vraiment) donne le vertige.
L'acrobate est sobre, intense, saisissant. Il fait vibrer en chacun de nous, une corde sensible qui devient corde raide ; nous titubons de ses déséquilibres. L'engagement de l'artiste est palpable ; de la grande acrobatie, un théâtre physique, une plongée en abîme dans l'univers robotisé d'un nouveau Charlot des "temps modernes".
Tarif : 8€
INVITATION à destination des adhérents 2022 AVR-Loisir & Culture, SUR INSCRIPTION en utilisant le lien
Inscription et règlement* au plus tard le 2 mars
Renseignements : Pierrette 06 08 51 36 27
- par chèque à l’ordre de Amis du Vieux Revest – Loisir et Culture, à déposer ou poster sous enveloppe à l’adresse de
Amis du Vieux Revest – Loisir et Culture
Mairie du Revest Place Jean Jaurès 83200 LE REVEST-LES-EAUX
Adhésion 2022 : 10€ par chèque séparé ou en espèces, à ajouter au prix du billet si nécessaire, accompagné du bulletin d'adhésion complété
À compter du 1er mars, de nouvelles consignes de tri entrent en vigueur sur l’aire toulonnaise. Tous les déchets plastiques et métalliques, sans exception, pourront être triés dans le même bac.
par Sarah Aboutaqi
"Une petite révolution dans le monde du tri". C’est ainsi que Gilles Vincent, président du Sittomat (1), a présenté – non sans enthousiasme – les nouvelles consignes de tri. Un enthousiasme plutôt justifié puisque dans les faits, l’élu n’a pas tort.

À compter du 1er mars, le Sittomat étend les consignes de tri des emballages plastiques et métalliques sur son territoire. Désormais, tous les plastiques, sans exception, pourront être triés.
Aux traditionnelles bouteilles, bidons et flacons en plastique, s’ajoutent tous les emballages métalliques comme les canettes, boîtes de conserve, sachets, films d’emballages, pot de yaourt et même capsule de café.
Tous iront dans l’un des 850 bacs gris de collecte dispersés sur le territoire du Sittomat.
Un changement qui concerne 532.000 habitants de Toulon Provence Méditerrannée, Sud Sainte-Baume et de la Vallée du Gapeau.
Faciliter le geste de tri au quotidien
"Trois solutions de tri vont être proposées aux administrés: déposer ses journaux, cartons et autre papiers dans les bacs de couleur jaune; les bouteilles, bocaux et flacons en verre dans les bacs de couleur verte. À ce niveau, rien ne change, détaille Gille Vincent. La troisième possibilité leur permet désormais de déposer tous les déchets et emballages plastiques, dans les bacs gris. Là, c’est un grand changement pour tous. Forcément, plus besoin de se questionner pour savoir où doivent être déposées les différentes ordures ménagères en plastique. À l’heure actuelle, 40 à 60% des plastiques sont recyclés. L’objectif, à terme est d’atteindre les 100% ".
Les bacs de tri et colonne à opercule gris déjà en place sur le territoire se verront apposer une nouvelle étiquette adhésive, indiquant les nouvelles consignes.
Modernisation grâce au trieur optique
Une petite révolution qui intervient 25 ans après la mise en place du tri des déchets ménagers sur l’aire toulonnaise, rendu possible grâce à une modernisation des techniques de tri.
"Aujourd’hui, nous avons trouvé des méthodes pour trier les plastiques, tout en améliorant les conditions de travail, explique Christine Leuthy-Molina, directrice régionale sud est de Citeo (2). Nous avons à disposition des trieurs optiques dans les centres de tri, qui par des faisceaux lumineux, vont pouvoir séparer les différentes résines de plastiques. Ce qu’un trieur manuel ne peut pas faire. Si on veut maintenir une cadence et maîtriser les coûts, c’est la solution la plus adaptée. Mais cela à un coût: le montant d’un trieur optique s’élève à 150.000 euros, et il en faut plusieurs. Voilà pourquoi cela a mis du temps ".
Et le président du Sittomat de préciser sur ce point: " certaines autres régions peuvent déjà trier tous les emballages plastiques ensemble depuis des années déjà, certes. Sur le secteur, nous avons choisi d’agir différemment en développant d’abord une usine de valorisation énergétique. Le centre de tri situé à La Seyne-sur-Mer, permet notamment de chauffer énergétiquement la Beaucaire, à Toulon, et la cité Berthe à La Seyne. Nous avons avancé à notre rythme, et aujourd’hui, nous y arrivons enfin ".
Direction un centre tri dans le Gard
Où vont ensuite tous ces emballages plastiques? "Le cheminement se fait en trois étapes ", indique Christine Leuthy-Molina.
Une fois le tri déposé dans le bac gris, les plastiques sont collectés et acheminés à La Garde au centre de réception de la société VNI Environnement. "Le centre conditionne ensuite les emballages 'en balles' (paquets de marchandises enveloppés et/ou ficelés ndlr) afin de faciliter leur transport vers le centre de tri Paprec Sud Gard, à Nîmes".
Dernière étape: les matières sont acheminées au centre de tri où elles sont séparées et transportées vers un centre spécialisé pour leur transformation.
Cette solution est transitoire dans l’attente de la création d’un centre de tri local (lire ci-dessous), "capable de séparer les emballages en plastique nouvellement triés", conclut-on du côté du Sittomat.
1. Le Syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise.
2. Citeo est une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques.
Compléments sur le site de Sittomat
Grâce à l’extension de ses consignes de tri, le SITTOMAT permet désormais aux habitants du territoire de trier leurs emballages en plastique et en métal dans le bac de collecte à couvercle gris.
Par définition, le recyclage permet d’économiser des ressources naturelles nécessaires à la fabrication de nouveaux objets. Afin de préserver toujours plus de ressources et de faciliter le quotidien de ses administrés, le SITTOMAT permet désormais de trier nombre d’emballages plastiques et métalliques supplémentaires.
Le tri de ces déchets permettra au SITTOMAT de collecter 2600 tonnes de déchets en plus chaque année, soit 4,5kg par an et par habitant.
Jusqu’à présent, nous pouvions trier dans le bac gris uniquement les bouteilles et flacons en plastique.

Dorénavant, à partir du 1er mars 2022, vous pourrez trier dans ce même bac tous les emballages en plastique et en métal suivants :
Les sachets et films d’emballages
Sachets de chips
Sachets de fromage râpé
Sachets distribués dans les commerces
Films alimentaires
Films de packs d’eau ou de lait Les pots et barquettes
Barquettes de beurre
Barquettes de jambon
Barquettes alimentaires
Pots de crème fraîche
Pots de yaourt
Barquettes de viande
Boites d’œufs en plastique Les emballages métalliques
Canettes
Bombes aérosol
Boîtes de conserve
Bouteilles de sirop
Barquettes aluminium Les petits métaux
Couvercles de bocaux
Capsules de café en aluminium
Capsules de bouteilles
Emballages de médicaments en aluminium
Pots en métal
Bougies chauffe-platGrâce aux nouvelles consignes de tri, c’est facile : plus d’emballages recyclés pour moins de matières premières gaspillées !
Les conclusions des Assises nationales de la forêt et du bois, lancées par le gouvernement en octobre 2021 avec pour objectif de « penser la forêt française de demain », devraient être rendues dans les prochains jours. Un des axes majeurs de cette réflexion concernait le renforcement de la résilience des forêts et la préservation de la biodiversité.
 Été 2020, monoculture d’épicéas morts en Argonne, région naturelle chevauchant les départements de la Marne, des Ardennes et de la Meuse (sept. 2020). Sylvain Gaudin, CC BY-NC-ND
Été 2020, monoculture d’épicéas morts en Argonne, région naturelle chevauchant les départements de la Marne, des Ardennes et de la Meuse (sept. 2020). Sylvain Gaudin, CC BY-NC-ND
Car la forêt française est aujourd’hui en crise : depuis deux décennies, on assiste en effet à une mortalité croissante des peuplements forestiers et à une baisse globale de leur productivité. Si la surface boisée en France métropolitaine ne cesse de croître depuis le milieu du XIXe siècle, c’est en raison du boisement – spontané ou artificiel – de terres agricoles, car la superficie occupée par des forêts anciennes, elle, ne cesse de diminuer.
Ce « dépérissement », est généralement attribué aux modifications climatiques. Les sécheresses estivales récurrentes fragilisent les arbres et la douceur hivernale favorise les pullulations de bioagresseurs, en particulier les scolytes et les hannetons.
Le changement climatique en est sans aucun doute une cause essentielle, mais il est aussi le révélateur d’écosystèmes forestiers fragilisés par des décennies de pratiques sylvicoles focalisées sur la production de bois. Non seulement la forêt française fixe moins de carbone par unité de surface, mais l’exploitation des peuplements dépérissants induit des émissions supplémentaires de CO₂ aggravant l’effet de serre et les changements climatiques associés.
Dans un tel contexte, adapter la forêt française est plus qu’une nécessité, c’est une urgence.
L’arbre ne doit plus cacher la forêt
Les forêts ne sont pas des champs d’arbres, mais des écosystèmes avec de multiples interactions entre les différentes composantes.
Le promeneur a tôt fait de constater que les descentes de cimes et les mortalités de masse concernent surtout des plantations monospécifiques, constituées d’arbres de même âge, correspondant souvent à des essences introduites hors de leur territoire d’indigénat.
C’est le cas de nombreuses plantations d’épicéa en plaine, tandis que les pessières naturelles d’altitude résistent plutôt bien. Les premières constituent des peuplements simplifiés sensibles aux aléas climatiques (tempêtes, sécheresses, incendies) et aux attaques de bioagresseurs (insectes, champignons…), tandis que les secondes, beaucoup plus hétérogènes et diversifiées, sont plus résilientes.
Même s’il existe une sensibilité propre à chaque essence et à chaque situation stationnelle, les impacts directs et indirects du dérèglement climatique sont modulés par l’intégrité fonctionnelle de l’écosystème forestier, qui est elle-même largement influencée par la sylviculture.
Adapter la forêt, c’est agir sur la santé de l’écosystème et non simplement remplacer des arbres mourants par d’autres. C’est un traitement de fond des causes du dépérissement qu’il faut entreprendre et non un simple traitement des symptômes. La forêt ne peut plus être réduite à ses arbres et à sa fonction de production : seule une vision écosystémique peut être salvatrice.
La nécessaire adaptation des pratiques sylvicoles
Le principal levier permettant d’adapter la forêt française repose sur la promotion de pratiques sylvicoles prenant davantage en compte le fonctionnement des écosystèmes forestiers dans leur ensemble ; cela pour améliorer durablement leur état de santé, leur résilience, et accroître leur capacité à séquestrer et à stocker du CO2.
D’abord, il faut réserver chaque essence à des stations présentant des conditions optimales pour elle, actuellement et en prenant en compte l’évolution modélisée du climat sur des pas de temps cohérents avec le cycle sylvicultural. Il faut aussi privilégier les peuplements mélangés (plusieurs essences) et structurellement hétérogènes (plusieurs hauteurs et formes de houppiers), de manière à renforcer la résistance aux aléas météorologiques et aux attaques de bioagresseurs.
 Forêt mélangée des Vosges du Nord - sept. 2021. Evrard de Turckheim, CC BY-NC-ND
Forêt mélangée des Vosges du Nord - sept. 2021. Evrard de Turckheim, CC BY-NC-ND
Privilégier la régénération naturelle permet d’accroître la diversité génétique soumise à la sélection naturelle et les capacités d’adaptation locale, contrairement aux plantations. Cela implique une meilleure gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique, notamment en favorisant la végétation accompagnatrice qui protège les plants sensibles et fournit une ressource alimentaire alternative.
Il existe déjà des modes de sylviculture mettant en œuvre ces principes, comme la futaie irrégulière ou jardinée. Ce type de sylviculture n’est pas nouveau, il a été adopté depuis 2017 par l’Office national des forêts pour toutes les forêts publiques franciliennes afin d’éviter les « coupes à blanc ».
 Coupe à blanc d’une parcelle de Douglas dans une forêt de l’Oise. Guillaume Decocq, CC BY-NC-ND
Coupe à blanc d’une parcelle de Douglas dans une forêt de l’Oise. Guillaume Decocq, CC BY-NC-ND
Face aux sécheresses récurrentes, il faut adapter la densité des peuplements au bilan hydrique de la station et préserver l’alimentation en eau des sols, y compris en limitant leur tassement.
Plus généralement, accroître la résilience des forêts nécessite de favoriser la biodiversité au sein de tous les compartiments de l’écosystème. Celle-ci est encore trop souvent perçue comme une contrainte pour le forestier, comme un obstacle à la gestion, alors même que c’est son assurance sur le long terme pour maintenir la fertilité des sols, la résistance aux bioagresseurs et, in fine, la capacité de production de bois.
Une condamnation sans procès des essences autochtones
Plusieurs documents de planification, comme les Plans régionaux Forêt-Bois (PRFB) considèrent un peu hâtivement que les essences indigènes ne sont plus adaptées au « nouveau » climat. Cette vision fixiste du monde vivant oublie que les essences forestières européennes ont déjà connu bien des changements climatiques (notamment un Petit Âge glaciaire et un Optimum médiéval). Pire, elle ignore nombre de travaux scientifiques récents qui mettent en lumière des capacités d’adaptation insoupçonnées des arbres.
Au moins trois ensembles de mécanismes permettent l’adaptation spontanée des arbres en environnement changeant : les mécanismes génétiques, via la sélection naturelle qui agit sur le long terme, ce qui nécessite une certaine diversité génétique ; les mécanismes épigénétiques, qui prédisposent des individus à des conditions environnementales que leurs parents ont vécues, via des marques induites capables de moduler l’expression des gènes et d’induire des mutations ; les mécanismes holobiontiques, via les symbioses issues de la co-évolution entre l’arbre et son microbiote, ce dernier contribuant à de nombreuses fonctions vitales.
 Forêt mélangée dans le Sud amiénois où les épicéas sont épargnés par les attaques de scolytes - oct. 2021. Guillaume Decocq, CC BY-NC-ND
Forêt mélangée dans le Sud amiénois où les épicéas sont épargnés par les attaques de scolytes - oct. 2021. Guillaume Decocq, CC BY-NC-ND
L’efficacité de ces différents mécanismes face à des changements climatiques rapides est encore mal connue, d’où l’intérêt de pouvoir observer la réponse des essences autochtones dans un contexte « naturel », c’est-à-dire hors forêt soumise à la sylviculture.
À cet égard, il est important d’augmenter les superficies d’aires forestières protégées et leur représentativité des différents contextes climatiques et des types de sols, comme souligné dans la contribution du Conseil national de la protection de la nature aux Assises de la forêt et du bois.
Ces espaces à naturalité élevée constituent non seulement des réservoirs de biodiversité préservée, mais aussi des laboratoires grandeur nature pour la compréhension de la biologie des espèces et des dynamiques forestières spontanées, indispensables à l’acquisition de références pour concevoir les itinéraires sylviculturaux de demain.
Une fausse bonne idée : le recours aux essences exotiques
La prétendue « inadaptation » des essences autochtones justifie le recours à des essences exotiques, venant souvent d’autres continents, dont l’intérêt et l’innocuité sont plus que douteux… L’idée de privilégier les essences naturellement résistantes au stress hydrique serait séduisante, si elle ne faisait pas preuve d’une certaine amnésie (en plus de faire l’impasse sur des millions d’années d’histoire évolutive).
Car l’introduction d’essences exotiques en forêt n’est pas nouvelle. Beaucoup se sont soldées soit par des échecs d’acclimatation, soit par de graves crises écologiques : introductions accidentelles de bioagresseurs exotiques (l’actuelle épidémie de chalarose du frêne en est un exemple parmi des dizaines d’autres), invasions biologiques (le cerisier tardif, jadis vanté pour ses mérites en foresterie est devenu aujourd’hui l’ennemi du forestier), érosion de la biodiversité autochtone (les sous-bois fantomatiques de nombreuses plantations de conifères en plaine en sont un exemple criant) ; ou encore, aggravation des conséquences de certains aléas (les méga-feux que connaît la Péninsule ibérique sont étroitement liés aux plantations d’eucalyptus, très inflammables, et pourtant promues en région méditerranéenne française).
 En forêt de Compiègne, invasion par le cerisier tardif - juin 200). Guillaume Decocq, CC BY-NC-ND
En forêt de Compiègne, invasion par le cerisier tardif - juin 200). Guillaume Decocq, CC BY-NC-ND
Une analyse détaillée de ces risques est présentée dans un livre blanc sur l’introduction d’essences exotiques en forêt, récemment publié par la Société botanique de France.
Les risques associés aux essences exotiques, difficilement prévisibles, mais réels et coûteux pour la société, justifient que les nouvelles plantations soient davantage réglementées. Celles-ci devraient faire l’objet d’une étude d’impact préalable avec analyse de risque.
Plus généralement, il est urgent d’évaluer le rapport bénéfice/risque à moyen et à long terme de ces plantations, et, dans l’attente d’une telle évaluation, de soumettre à un moratoire les mesures politiques et financières incitant leur introduction en forêt.
Mieux prendre en compte les résultats de la recherche scientifique
Cet effort indispensable pour adapter la gestion des forêts aux changements climatiques ne doit pas se limiter aux actions d’ingénierie, mais reposer sur une approche scientifique interdisciplinaire, fondée sur l’ensemble des apports récents des sciences et techniques de la conservation.
La recherche scientifique en écologie forestière en particulier est très mobilisée sur la question des impacts des changements climatiques sur la forêt et des capacités adaptatives des espèces.
Les nombreux résultats de la recherche permettraient d’appuyer les stratégies de gestion et de planification forestières sur des bases scientifiques robustes. Pourtant ces résultats sont jusqu’ici peu ou pas pris en compte par les décideurs.
La gestion durable des forêts ne peut pourtant reposer sur la seule ingénierie, tout comme elle ne peut se réduire aux seuls arbres. Agir en environnement changeant et en univers incertain suppose d’intégrer nos connaissances scientifiques dans tous les domaines, de prendre en compte l’évolution des attentes sociétales et d’actualiser les outils des ingénieurs.
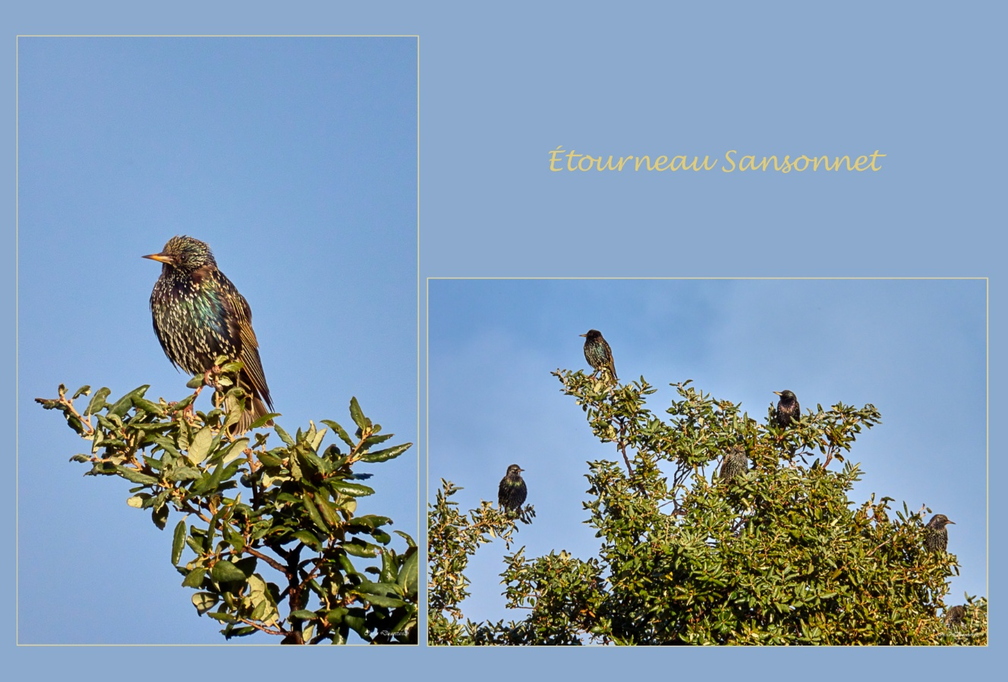 Photo © Cécile Di Costanzo
Photo © Cécile Di Costanzo

