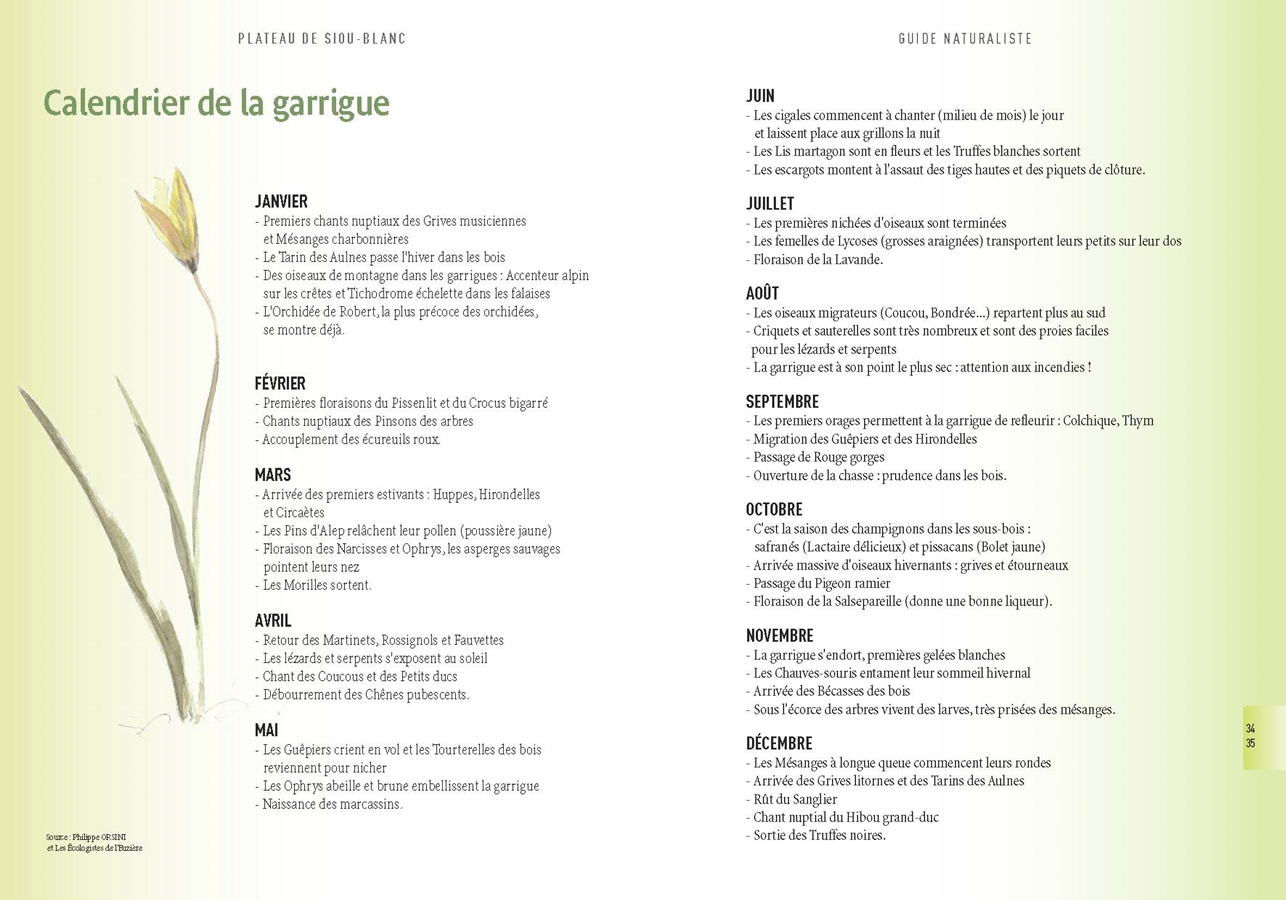Liste des liens
Alors que les pénuries d’eau s’installent sur l’ensemble de la France, promenons-nous dans la garrigue. Ce milieu typique du pourtour méditerranéen foisonne de plantes adaptées à la sécheresse. Pour autant, il reste menacé.
 Nombre de végétaux méditerranéens germent et fleurissent à l’automne. - © David Richard / Reporterre
Nombre de végétaux méditerranéens germent et fleurissent à l’automne. - © David Richard / Reporterre
Ça pique, ça griffe, ça gratte. Sous un soleil déjà vif, notre balade printanière prend vite des airs de parcours du combattant. Slalomer entre les chênes kermès aux feuilles dentelées et les genêts scorpions, veiller à ne pas trébucher sur les rocailles, guetter l’ombre bienfaisante d’un pin. « Bienvenue dans la garrigue ! » dit dans un sourire Thibault Suisse. Notre guide du jour est botaniste au sein des Écologistes de l’Euzière, une association héraultaise qui fait, entre autres, de l’éducation à l’environnement.
« La particularité de ce milieu, c’est qu’il est semi-aride », explique le naturaliste. Et c’est justement ce qui nous amène ici, dans ce massif buissonnant à quelques kilomètres de Montpellier : en ces temps de sécheresse chronique, la région méditerranéenne, qui vit depuis des millénaires sans beaucoup d’eau, fait figure de modèle. Demain peut-être, d’autres zones de France ressembleront à ces collines pelées et étonnantes.
 En ces temps de sécheresse chronique, la garrigue, qui vit depuis des millénaires sans beaucoup d’eau, fait figure de modèle en France. © David Richard / Reporterre
En ces temps de sécheresse chronique, la garrigue, qui vit depuis des millénaires sans beaucoup d’eau, fait figure de modèle en France. © David Richard / Reporterre
L’habit ne fait pas le moine, dit l’adage. Et la garrigue, sous ses allures revêches, cache une multitude d’espèces aux super-pouvoirs. Pour survivre ici, la végétation a en effet dû s’adapter au manque d’eau, aux étés caniculaires, aux feux…
Petits, feuillus et luisants
Première singularité, « les plantes d’ici ne perdent pas leurs feuilles, explique Thibault Suisse. Elles les gardent toute l’année pour pouvoir faire de la photosynthèse et se développer dès que les conditions sont optimales ». Nombre de végétaux méditerranéens germent et fleurissent ainsi à l’automne, quand la plupart de leurs congénères continentaux préfèrent le printemps ou l’été. Autre originalité, leur taille : « Plus on est petits, moins a besoin d’eau », précise le naturaliste.
Face aux sécheresses, il s’agit aussi — et surtout — de garder son eau, autrement dit, de ne pas trop transpirer. « Beaucoup d’espèces ont développé la “technique du K-Way”, souligne notre guide. Leurs feuilles sont enduites d’une mince pellicule de cire, qu’on appelle une cuticule. » Avec leur feuillage luisant, le chêne kermès ou le chêne vert suent moins l’été.
Autre astuce imparable : « Le thym ou le romarin ont des feuilles toutes fines, le genévrier cade s’est plutôt doté d’aiguille, décrit le naturaliste. Le genévrier de Phénicie a opté pour des sortes d’écailles. » Différentes options pour un même résultat : réduire la surface d’évapotranspiration.
 Le genèvrier cade s’est doté d’épines pour réduire la surface d’évapotranspiration des feuilles. © David Richard / Reporterre
Le genèvrier cade s’est doté d’épines pour réduire la surface d’évapotranspiration des feuilles. © David Richard / Reporterre
Poils et huiles essentielles
Le botaniste sort de sa poche une petite loupe pour inspecter le dessous pelucheux d’une feuille de romarin. « Ces petits poils ont une double fonction, explique-t-il. Ils font office de double-vitrage pour mieux isoler la plante, et reflètent la lumière du soleil, grâce à leur blancheur. »
La plante aromatique dispose d’un ultime super-pouvoir : ses huiles essentielles. « L’évaporation, ça rafraîchit », rappelle Thibault Suisse, d’où l’agréable sensation de fraîcheur quand on sèche au sortir d’un bain de mer ou de rivière. Mais comment transpirer sans perdre d’eau ? En laissant se volatiliser des corps gras, moins denses que l’or bleu. La garrigue est ainsi parsemée de ces espèces odorantes qui font saliver les promeneurs.
Qui dit milieu sec, dit également risque de feu. Beaucoup de végétaux font donc avec les flammes. Le botaniste évite soigneusement un tapis de fleurs jaunes — des narcisses de garrigue. « C’est une espèce à bulbe, ce qui lui permet d’avoir ses réserves d’eau et de nutriments sous terre », indique-t-il. Pratique en cas d’incendie qui ravagerait la surface.
Un milieu menacé
D’autres plantes, comme les cistes ou l’olivier, se sont particulièrement accommodées des brasiers. « Les graines de ciste germent bien mieux après avoir été soumises à de fortes températures. On peut reproduire ça en les passant au four, développe Thibault Suisse. Quant à l’olivier, ses noyaux se développent très bien dans les cendres. » Il n’est ainsi pas rare de découvrir des jeunes pousses dans les restes grisâtres d’un barbecue où l’on aurait jeté les résidus de l’apéro.
Le naturaliste est insatiable. Il ne cesse de se pencher vers le sol, pointant du doigt ici une salade sauvage, là une jonquille, là-bas une jeune touffe de thym. Contrairement aux apparences, « la garrigue abrite une richesse et une variété végétales remarquables, insiste-t-il. 80 % des quelque 6 000 espèces de plantes connues en France sont présentes ici ». La région méditerranéenne est ainsi ce qu’on nomme « un “hot-spot” de biodiversité ».
Un milieu exceptionnel, mais menacé. Par l’urbanisation galopante et le recul du pastoralisme — les moutons ont longtemps permis de garder ces milieux ouverts, laissant s’épanouir une flore singulière. Mais aussi par le changement climatique. « La végétation est adaptée aux sécheresses estivales, mais pas au manque d’eau chronique et aux sécheresses précoces, en début d’année », souligne John Thompson, écologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
D’autant plus que le pourtour méditerranéen se situe aux avant-postes de la crise climatique. « Les espèces peuvent s’adapter, elles ont moins de feuilles par exemple, mais il y a des limites en matière de température et de disponibilité en eau », abonde Isabelle Chuine, directrice de recherche au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS.
Une région condamnée à la mutation
Reste le déplacement. « Des études menées sur l’ensemble de la flore montre qu’elle remonte vers le nord et les sommets, indique Isabelle Chuine. Le chêne vert, par exemple, se retrouve le long de la façade Atlantique. » Les espèces xérophytes du sud, qui aiment la sécheresses, pourraient ainsi se disséminer dans certaines zones de l’ouest et du centre de la France.
Alors, garrigue partout ? « Ce n’est pas si simple, nuance John Thompson. Il y a d’autres facteurs qui jouent : les sols appropriés par exemple. » Il faut aussi que les végétaux puissent essaimer, grâce aux pollinisateurs ou aux oiseaux. « Le déclin des insectes, les barrières que constituent les routes, les villes freinent ce processus… On empêche la nature de se déplacer », prévient le chercheur.
La région méditerranéenne semble bien condamnée à la mutation. « La végétation pourrait se modifier et ressembler à celle de l’Andalousie ou de l’Afrique du Nord, esquisse Isabelle Chuine. Moins dense, plus pauvre d’un point de vue biodiversité. » D’ici la fin du siècle, la garrigue pourrait peu à peu laisser place à un milieu semi-désertique.
La roche calcaire est la reine des garrigues méridionales.
Les défrichements séculaires, le mouton et l'agressivité du climat l'ont mise partout en évidence. Elle est dure, saillante, souvent acérée. La pierre, omniprésente sur les sentiers, sonne sous le pied. Elle dessine les barres rocheuses, les baous chers à Pagnol, comme les combes qui rythment les paysages de Cuers à la Sainte Baume.
Durant plus de 100 millions d'années, pendant l'ère secondaire, la mer a occupé une grande partie de la Provence. Elle y a déposé d'épaisses couches de calcaire provenant des coquilles d'invertébrés marins, superposées en strates de différentes hauteurs. Un mètre d'épaisseur représente, selon la profondeur de la mer, entre 2000 à 100 000 ans de dépôts.
Chaque strate épaisse ou fine, dure ou friable, claire ou rougeâtre, à grains fins ou grossiers, chaque strate est un enregistrement des conditions environnementales d'une époque : climat, profondeur de la mer, relief du continent voisin... Une faible profondeur, une mer chaude, une longue période de même niveau marin sont en général les conditions les plus propices à la constitution d'une sédimentation calcaire épaisse.
Une caractéristique majeure des massifs calcaires est leur grande, leur intense fracturation. Elle va de la minuscule fissure au gouffre le plus large, en passant par l'aven caché sous les herbes et les ronces. En surface le carbonate de calcium dissous par les pluies, acidifiées par l'humus des sols, est vite entrainé par l'excellent drainage des calcaires crevassés.
Ne restent sur place, piégées dans les creux et les poches, que des argiles, non solubles, qui sont une impureté du calcaire originel.
Le climat méditerranéen, fait de précipitations brutales et brèves, suivies de longues périodes de sécheresse, favorise l'oxydation du fer que contiennent les argiles. Plus le climat est chaud, plus l'oxydation est forte et le sol rougeâtre. Quand ces sols sont épais et ne contiennent pas de calcaire, ces sols sont très fertiles. D'où parfois ces labours au fond de petites combes.
Le mot garrigue, à l'origine ancienne, désignait des territoires fortement anthropisés, des territoires fortement marqués par l'activité humaine. Aujourd'hui, les jeunes forêts de chênes et de pins s'installent sur les garrigues, mais l'homme qui a délaissé ces territoires, conserve cette appellation. Une nostalgie, une habitude ? Peut être... La plupart de ces espaces évolue rapidement mais, pour l'homme, ils demeurent la garrigue.
Ces territoires anthropisés étaient jadis le domaine des chaufourniers (chaux, poix, cade, les enguentiés), des charbonniers, des chasseurs à la glu, au filet, au fusil, des cueilleurs d'asperges, salades, petit bois, des fabricants de balais, des gemmeurs, et cela principalement autour des villes et tout au long de la côte.
Il faut cependant, tout en respectant l'attachement au mot, discerner les plantes qui aujourd'hui colonisent les terrains calcaires de ces garrigues millénaires : pelouses, forêts, et entre eux deux, ces espaces ouverts où dominent les plantes ligneuses et qui ne sont plus des pelouses et pas encore des forêts, et que la communauté scientifique qualifie sous le mot d'origine espagnole, matorral. Le matorral c'est cet espace sans arbre que colonisent cyste, genet, calycotome, coronille, bruyère, chêne kermès..
En Provence le matorral présente une grande diversité : le Chêne kermès, la Coronille à tige de jonc, le Genêt scorpion s'associent aux arbustes tel le Filaire à feuilles étroites, le Pistachier térébinthe, le Cade... tandis que la pelouse où jadis courrait le mouton, se couvre de Brachypode rameux, de Thym, de Lavande...
Les garrigues s'étagent de la mer à la limite de l'Olivier, zone où les plantes des terrains arides ont disparu. Au delà, sur les plateaux calcaires d'altitude moyenne, comme les coteaux du Ventoux, les formations végétales proches en apparence ne peuvent plus s'appeler garrigues, terme réservé à la zone méditerranéenne telle que définie par la limite de croissance de l'Olivier, selon la définition reconnue du botaniste Charles Flahault (1852 - 1935).
Le Chêne vert ou la Cigale plébéienne, illustres représentant du monde méditerranéen, auraient pu être choisis pour définir cette zone, mais... ils se retrouvent dans d'autres régions. La Camphorée de Montpellier, par contre, couvre le même périmètre que l'Olivier mais... mais la Camphorée ne porte pas sur sa corolle autant de symboles que l'Olivier.
En cela nous devons remercier Homère !