Liste des liens
Cordiste, ce Revestois exécute des travaux de maçonnerie sur les toits de Toulon, qu’il s’est mis à photographier au fil des ans. Jusqu’à vouloir en faire profiter le public.
Publié le 07/06/2022 à 16:34 par Mathieu Dalaine
 Cordiste de profession, le Revestois Christian Maurel arpente les toits toulonnais dans le cadre de sa profession et en profite pour faire des photos surprenantes sur la commune. Photo Frank Muller
Cordiste de profession, le Revestois Christian Maurel arpente les toits toulonnais dans le cadre de sa profession et en profite pour faire des photos surprenantes sur la commune. Photo Frank Muller
Au royaume des vieilles tuiles, graffeurs et monte-en-l’air sont rois. C’est ici aussi, sur les toits du centre-ville de Toulon, que Christian Maurel passe l’essentiel de ses journées. Depuis trente ans, ce travailleur acrobatique répare les verrières, les châssis à tabatière et traque les fuites d’eau de ce palais à ciel ouvert; le tout suspendu à vingt mètres au-dessus du sol.
"Et puis, un jour, alors même que je venais de m’offrir un appareil photo, je me retourne et prends conscience que c’est ça qu’il faut photographier…" Ça, c’est le paysage azur et ocre qui s’ouvre devant lui, où s’empilent le haut des immeubles anciens et le bleu de la Méditerranée. Cheminées, puits de lumière, balcons oubliés se révèlent comme depuis aucun autre promontoire toulonnais.
Christian voit plus loin. "J’ai imaginé des cadres qui mettaient en valeur mes clichés: des créations en forme de grue, d’échafaudage, d’altana… Je dois maintenant trouver un lieu suffisamment grand pour que je puisse les exposer! Mais mon titre est tout trouvé: ‘‘Entre toits, émoi’’".
Le photographe photographié!
 En plein travail au-dessus du boulevard de Strasbourg, Christian Maurel a pris la pose. Il œuvrait ce jour-là à refaire l’étanchéité d’un altana. Photo Frank Muller
En plein travail au-dessus du boulevard de Strasbourg, Christian Maurel a pris la pose. Il œuvrait ce jour-là à refaire l’étanchéité d’un altana. Photo Frank Muller
Ces verrières pyramidales ou coniques, au nombre de 150 à Toulon, visent à apporter de la lumière dans les cages d’escalier.
C’est au milieu du XIXe siècle, alors qu’est adopté le principe d’une surélévation des immeubles du centre, que les premiers ont vu le jour.
500 photos à son actif
 Christian confie avoir pris plus de 500 photos des toits de Toulon.
Christian confie avoir pris plus de 500 photos des toits de Toulon.
"Suivant l’heure, l’orientation, la météo, les paysages se transforment".
À Besagne, la ligne d’horizon se compose de silhouettes de frégate et de paquebot, ainsi que des grues du port militaire.
Quand la luminosité tombe, la vieille ville semble happée par le bleu de la mer.
Spectateur de la métamorphose du centre ancien
 Depuis 2012, le photographe voit l'évolution du centre ancien Photo DR.
Depuis 2012, le photographe voit l'évolution du centre ancien Photo DR.
"Mon travail est à la fois esthétique et historique".
Depuis 2012 qu’il s’est mis à photographier tous azimuts, Christian Maurel a vu l’évolution du centre ancien, comme ici l’îlot Baudin avant sa réhabilitation.
"La transformation est réellement impressionnante", assure celui-ci.
La richesse des toits de Toulon
 La richesse des toits de Toulon et ses grues. Photo DR.
La richesse des toits de Toulon et ses grues. Photo DR.
Le cap Sicié et la rade en toile de fond. Les toits de Toulon et leurs tuiles montrent leur richesse. "On découvre des balcons cachés, des nids de gabians entre les cheminées, du linge suspendu…", détaille Christian Maurel.
Et toujours ces grues que les photographies officielles oublient souvent de montrer lorsque l’objectif s’oriente vers la mer.
Le beffroi de l’ancienne Caisse d’Épargne, joyau "aérien" des toits de Toulon
 Le beffroi de l’ancienne Caisse d’Épargne, qui surplombe aujourd’hui l’opéra, est l’un des joyaux "aériens" des toits de Toulon. Photo DR.
Le beffroi de l’ancienne Caisse d’Épargne, qui surplombe aujourd’hui l’opéra, est l’un des joyaux "aériens" des toits de Toulon. Photo DR.
Érigé en 1895, le beffroi de l’ancienne Caisse d’Épargne, qui surplombe aujourd’hui l’opéra, est l’un des joyaux "aériens" des toits de Toulon. "Avec le campanile de la cathédrale, la toiture de l’ancien palais de justice ou les halles, évidemment", sourit Christian Maurel
Un portulan médiéval découvert dans un registre de notaire du XVIe siècle !
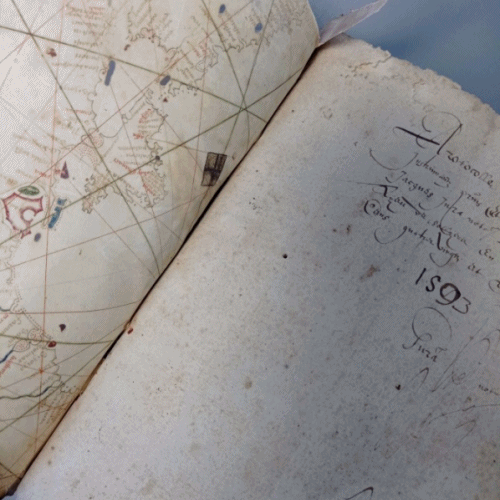
Au détour d'une recherche en salle, une lectrice assidue, Madame Germain, a découvert un portulan médiéval en parchemin réutilisé comme couverture d'un registre de notaire du XVIe siècle. Cette carte représente la côte orientale de la Méditerranée : Egypte, Grèce et mer noire. Voulant approfondir le sujet, nous sommes allés vérifier dans les autres registres de l'étude et nous avons découvert dans un autre registre l'autre moitié de cette même carte représentant cette fois la Méditerranée occidentale : Italie, Sardaigne, Corse et même les côtes provençales ! Il pourrait s'agir d'un portulan de la deuxième moitié du XVe siècle attribué au cartographe Petrus Roselli de l'école majorquine de cartographie.
Le béton couvre les champs : entre 1970 et 2020, l’équivalent de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a disparu, selon un rapport de la Safer, la fédération chargée de réguler le foncier agricole.
Les terres agricoles sont en piteux état. C’est ce que décrit la dernière édition du rapport annuel de l’antenne nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), publié le 24 mai. L’organisme y dresse un panorama inquiétant de l’état du marché foncier rural. Urbanisation, concentration des exploitations, accaparement des terres… Ces dynamiques se sont accentuées l’année dernière, mettant en péril l’essor d’un modèle agricole respectueux du vivant.
Premier constat : l’urbanisation s’est envolée en 2021. 33 600 hectares de terres agricoles (soit l’équivalent de 48 000 terrains de foot) ont été vendus pour être artificialisés. Cela représente une hausse de 23,5 % par rapport à 2020. Ce niveau est « inédit » depuis 2009, précise le rapport. Le bétonnage est particulièrement marquée sur la côte ouest du territoire et dans l’arrière-pays méditerranéen. Les responsables, note le rapport, sont tout autant les particuliers que les personnes morales de droit privé (sociétés commerciales, associations, fondations…).
La Safer explique cette hausse spectaculaire par la relance de l’économie post-confinement. Autre hypothèse : les acteurs privés ont peut-être anticipé certaines restrictions de la loi « Climat et résilience », qui fixe l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. L’approche de sa mise en application a peut-être « accéléré » les projets immobiliers, suggère l’organisme, et incité les bétonneurs à se ruer sur les terres agricoles avant qu’il ne soit trop tard.
Quelles que soient les raisons de ce boom, les conséquences sont là : toujours plus de construction, et toujours moins de champs. Entre 1970 et 2020, la surface agricole a reculé de 10,2 %, rappelle la Safer. Cela représente 3 millions d’hectares. Soit quasi exactement la taille de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce phénomène peut interroger : le marché des terres agricoles est en théorie régulé par les Safer, qui jouent un rôle de « gendarme » du foncier rural. Toute vente doit obligatoirement être signalée aux Safer locales. Si elles considèrent que le prix d’achat, l’acheteur ou son projet ne sont pas adéquats, elles peuvent « casser » la transaction en utilisant leur droit de préemption, et choisir elles-mêmes le nouvel acquéreur. Comment se fait-il que l’urbanisation de terres agricoles passe sous leur radar ?
« Ce sont les collectivités locales qui décident de l’usage du foncier dans leurs territoires, explique à Reporterre le président de la fédération nationale des Safer, Emmanuel Hyest. Si elles décident [dans leur plan local d’urbanisme, PLU] de transformer un terrain classé comme agricole en une “zone à urbaniser”, les Safer ne peuvent plus intervenir. »
Le marché des maisons de campagne a explosé
En parallèle, le marché des maisons de campagne (c’est-à-dire les résidences secondaires vendues avec un terrain agricole ou naturel de moins de 5 hectares) a lui aussi explosé. Le nombre de transactions a augmenté de 21,3 % depuis 2020 (à titre de comparaison, le marché immobilier du logement ancien a progressé de 12 % en un an). 76 600 hectares sont concernés. La Bretagne, l’est de la Méditerranée et les alentours des Alpes sont les régions les plus prisées par les acheteurs, souvent originaires de grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.
Il est, là encore, difficile pour les Safer de préserver les terres agricoles qui font partie de ces propriétés : « Quand la Safer les préempte partiellement, il arrive que le propriétaire propose de vendre le bâti en même temps, raconte Emmanuel Hyest. Ce n’est pas facile pour la Safer d’accepter : il faut être sûr qu’un agriculteur va vouloir tout reprendre, ce qui est rarement le cas. Un agriculteur ne va pas acheter une maison pour récupérer cinq hectares. » Ce grignotage discret des terres par les particuliers se fait « au détriment de l’agriculture de production », explique-t-il.
Un autre nuage noir flotte au-dessus des champs : celui de l’agrandissement « excessif » des exploitations. Entre 1970 et 2020, leur nombre a diminué de 76 %, passant de 1 588 000 à 389 500. Leur taille n’a quant à elle fait que gonfler : sur la même période, elle a été multipliée par 3,64 (évoluant, en moyenne, de 18,8 à 68,6 hectares). Les fermes sont de plus en plus grandes, et les agriculteurs, eux, de moins en moins nombreux.
Des groupes industriels accaparent des milliers d’hectares de terres
Ces agrandissements vont de pair avec le déclin progressif des exploitations individuelles, au profit de sociétés agricoles. En 1970, 99,7 % des fermes étaient détenues par une seule personne. En 2020, elles ne représentaient plus que 58,4 % des exploitations agricoles. Le reste (41,6 %) existe sous forme de sociétés d’exploitation. La plupart du temps, ces sociétés sont mises en place pour faciliter la transmission familiale. Selon les estimations d’Emmanuel Hyest, environ 20 % d’entre elles se livrent cependant à un usage « détourné » des formes sociétaires. Les Safer n’ont en effet, pour le moment, aucun droit de regard sur les cessions de parts des sociétés. La forme sociétaire permet à des agriculteurs de revendre leurs terres aux mieux-disants, sans aucun contrôle. Cela facilite l’accaparement de milliers d’hectares de terres par des exploitants intensifs ou des groupes industriels, comme l’a documenté la journaliste Lucile Leclair dans son livre Hold-up sur la terre (Éditions du Seuil / Reporterre).
Les jeunes agriculteurs et la biodiversité sont les premières victimes de ce phénomène. Lorsque des petites fermes sont absorbées par de plus grosses structures, c’est souvent pour les remplacer par des systèmes de production peu écologiques. Les fermes à taille humaine (et notamment les élevages) disparaissent, au profit d’exploitations immenses et fortement mécanisées. La plupart du temps, elles sont dédiées à la monoculture de céréales à grand renfort de pesticides et d’engrais de synthèse. Cette uniformisation du paysage agricole « a un impact négatif sur la biodiversité, l’entretien des paysages et la résilience de l’agriculture face aux aléas climatiques », prévient la Safer. Elle empêche également une nouvelle génération d’agriculteurs, souvent portés sur l’agroécologie, de s’installer.
« Ce qu’il faut, c’est avoir des agriculteurs partout sur le territoire, avec des productions diverses », estime Emmanuel Hyest. Les menaces qui s’exercent sur le foncier mettent selon lui en péril la résilience du pays. « Tous les documents d’urbanisme disent qu’il faut avoir la consommation la plus sobre possible des terres agricoles. Désormais, il faut faire respecter l’esprit de ces lois. »
UNE NOUVELLE LOI PLUS RESTRICTIVE ?
Pour le moment, la Safer ne contrôle pas les cessions de parts des société agricoles, ce qui l’empêche de lutter efficacement contre l’accaparement des terres. La loi Sempastous, qui devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année, pourrait changer la donne. « Nous pourrons désormais intervenir, explique Emmanuel Hyest. Dans le cadre des exploitations reprises hors cadre familial et au-delà d’une certaine surface, nous pourrons autoriser la transmission des parts, donner un agrément sous condition (par exemple en exigeant la réorientation d’une partie des terres vers les jeunes agriculteurs), ou refuser l’agrément. »
Cette nouvelle loi parviendra-t-elle pour autant à freiner l’appétit foncier des multinationales ? Dans son livre Hold-up sur la terre, la journaliste Lucile Leclair émet quelques doutes. Les règles du marché des ventes de sociétés sont plus souples que celles du marché foncier classique, explique-t-elle. Si les entreprises parviennent à convaincre les autorités que leur projet contribue au développement du territoire, elles pourront obtenir un laissez-passer. Les « mesures compensatoires » évoquées dans le texte pourraient par ailleurs avoir des effets pervers. Le principe est d’autoriser de grands groupes à acheter des terres, à condition qu’ils cèdent quelques hectares à de jeunes agriculteurs en contrepartie. « On pourrait se retrouver avec une majorité de mégafermes côtoyant des petites fermes se développant sur les surfaces que l’agro-industrie veut bien céder, écrit la journaliste. L’essentiel est là : dans ce système, un modèle agricole domine l’autre. »

Du haut de ces 35 mètres, 110 ans nous contemplent. Érigé en 1912, le barrage du Revest ne fait pourtant pas son âge. Et pour cause: depuis 18 mois, un gigantesque chantier a été lancé par la Métropole TPM, son propriétaire, pour redonner à l’ouvrage une seconde jeunesse. Non que la retenue menaçait ruine – la maçonnerie d’origine est en bon état – mais l’Etat avait jugé prudent des travaux d’agrandissement de l’évacuateur de crues, de remise en service de la centrale hydroélectrique ou de confortement de la structure.
C’est l’entreprise NGE qui s’est chargée du génie civil, coulant pour l’occasion près de 7.000m3 de béton. Coût total de cette opération lifting: neuf millions d’euros. En octobre, la dernière pierre sera apportée à l’édifice; lequel sera prêt à affronter sans trembler les 110 prochaines années. Il fallait ça, sans doute: rappelons que plus d’un tiers de l’eau potable consommée par les Toulonnais est produite grâce au barrage.
1 Pour le chantier, la retenue de Dardennes et son million de m3 d’eau (à plein) ont été vidangés entièrement il y a un an. Une opération de pêche de sauvetage avait même été conduite pour transférer les poissons attrapés vers le lac de Carcès. Cela permet de découvrir un paysage fait de restanques, reliques d’un passé agricole florissant avant la construction du barrage. Début mai, les vannes ont toutefois été fermées et le réservoir, alimenté par un réseau karstique dépendant des pluies, est progressivement remis en eau.

2 "La première phase du chantier a consisté à élargir l’évacuateur de crues", note Vincent Skarbek, directeur des travaux pour NGE. Prévu pour un débit de 110m3 d’eau par seconde, ce grand caniveau de béton, qui accueille le trop-plein quand le lac déborde, est désormais capable d’encaisser une crue milénale et un débit deux fois supérieur. Objectif: mieux évacuer l’eau dans le Las et faire baisser la pression sur le barrage.

3 Elle ne fonctionnait plus depuis des années. Au pied du barrage, la micro centrale hydro-électrique a été modernisée et relancée, nouvelle turbine à l’appui. "L’idée est de produire de l’électricité pour alimenter l’usine de potabilisation de l’eau et de redistribuer le surplus d’énergie dans le réseau", résume Vincent Skarbek.

4 Dernière étape: "On va conforter le barrage avec un remblai fait de terre et de blocs de pierre, qui n’existait pas jusqu’alors", poursuit Vincent Skarbek.70% de ces matériaux proviennent du chantier. Haut de 17mètres, cette carapace va permettre d’accroître sensiblement la résistance de l’ouvrage de 154mètres de long.

5 Route fermée depuis deux ans au pied du barrage, jusqu’à 50 techniciens sur place, apport d’une raboteuse minière de 50 tonnes venue d’Italie pour grignoter la roche, contraintes techniques rares…: "Ce chantier a été en tous points exceptionnels", conclut Vincent Skarbek.
Les chapelles sont partout en Provence... Au cœur ou à la périphérie de chaque ville, de chaque village, de chaque hameau, érigées au sommet des montagnes, lovées au fond des gorges, émergeant des garrigues sauvages en gardiennes des champs, des vignes et des vergers, cachées au profond des forêts, dressées en bienveillantes vigies au-dessus de nos côtes... Quelle foi a poussé nos ancêtres à couvrir ce pays de ces témoignages de leur piété, de leurs espoirs mais aussi de leurs craintes ? Le christianisme a pénétré très tôt en Provence. Probablement dès la fin du 1er siècle de notre ère, s'il faut en croire la légende des saintes Maries échouées en Camargue ; et il faut croire aux légendes, car elles portent la vérité du cœur. Mais l'histoire nous enseigne aussi qu'au III° siècle, Arles est déjà le siège d'un évêché et c'est dans cette ville, en 314, que se tint le premier concile de l’Église alors que l'empereur Constantin 1er vient à peine de reconnaître la nouvelle religion. C'est dire l'implantation ancienne et profonde du christianisme dans la belle Provincia. Mais la religiosité des Provençaux a des racines plus profondes encore. Sous bien des édifices chrétiens dorment les vestiges de temples païens gallo-romains, recouvrant eux-mêmes quelquefois des lieux de culte celto-ligures.
 La Chapelle de Tourris ©Cécile di Costanzo
La Chapelle de Tourris ©Cécile di Costanzo
Les vierges noires et certains saints sont les héritiers d'anciens cultes agraires de fécondité. Ils en marquent à la fois la continuité et la mutation ; continuité, car, dans une Provence rurale à 80% jusqu'au début du XXème siècle, le paysan est d'abord préoccupé par le cycle des saisons, le temps qu'il fera et le rendement des cultures qui le nourrissent ; mutation, car la religion catholique substitue aux rites magico-religieux l'engagement de la foi personnelle. Ce changement de mentalité et de croyance profonde mettra plusieurs siècles à s'imposer au peuple. Car ce peuple est durement éprouvé : la famine le guette, la maladie le frappe cruellement, la peste le décime périodiquement, les barbares et les sarrasins le razzient et les seigneurs et les rois censés le protéger le plongent dans des guerres incessantes et meurtrières. Dans ces temps difficiles, les hommes demandent d'abord à Dieu aide et protection dans la vie présente et promesse d'une vie future... La Vierge et les saints qui sont perçus comme plus accessibles, plus humains, deviennent des intercesseurs privilégiés ; d'où une multitude de chapelles qui leur sont dédiées. Pourtant, au tournant de l'an mille, un miracle se produit. Un formidable essor religieux génère une vague de constructions, jamais égalée depuis. Du XI° au XII° siècle, l'Europe entière se couvre d'abbayes, de cathédrales, d'églises et de chapelles. Innovations architecturales et élan de foi s'unissent.
 Notre-Dame du Pieloun sur la colline de Costebelle au Revest
Notre-Dame du Pieloun sur la colline de Costebelle au Revest
C'est l'âge roman, le temps des grands pèlerinages, des croisades, des abbayes conquérantes, de la course aux reliques ; la réforme grégorienne assainit l’Église, qui est au faîte de sa puissance, le Christ règne en souverain des esprits et le culte marial s'impose partout... Le visage de la Provence en est durablement transformé. Jusqu'aux coins les plus reculés du pays, églises et chapelles lèvent comme moissons en été... Humbles ou fières, simples ou monumentales, les chapelles romanes ponctuent le paysage provençal. Dix siècles après, certaines, construites avec autant de soins que des cathédrales, n'ont presque pas bougé. D'autres ont été profondément remaniées. Dans leurs pierres, on lit l'évolution des styles, les flux et reflux des croyances et les vicissitudes de l'histoire. La Provence restera longtemps fidèle au modèle roman. Le style gothique, né en Île-de-France au XIII° siècle, n'aura que peu d'influence ici ; quelques villes y sont sensibles ( Avignon, Aix...), mais les campagnes lui sont réfractaires. Jusqu'au XV° siècle et même au-delà, on continue à construire selon le modèle roman.
 La chapelle des Moulins
La chapelle des Moulins
Il faudra attendre le XVI° siècle pour que la construction change. Les édifices sont plus vastes, mais construits en moellons et couverts d'un toit de tuiles sur charpente. Rare est la pierre de taille, les plans sont confus, les chevets sont plats et le décor sculpté disparaît... Heureusement, quelques fresques qui ornaient les murs nous sont parvenues. Les deux styles issus de la Renaissance, l'un fondé sur la raison, le classique, l'autre nourrit par la passion, le baroque, ont peu d'écho dans l'architecture religieuse locale, mais ils se retrouvent à l'intérieur des édifices, façonnant de magnifiques retables qui ornent le chœur des sanctuaires. Après la Révolution, qui a beaucoup détruit, le XIX° siècle s'est surtout attaché à reconstruire et à regagner les âmes. Il n'en ressort aucun style, car ses bâtisseurs n'ont fait que copier les styles précédents (néogothique en néo classique, romano-byzantin...). Le XX° siècle a vu la réalisation de quelques rares mais superbes œuvres. Les matériaux nouveaux ( béton, verre...) y sont au service d'un indéniable élan spirituel. Il faut aussi mettre à l'actif du présent l'effort considérable de restauration et de revalorisation du patrimoine religieux produit par les fidèles, des associations et des collectivités locales. Le plus remarquable enfin, c'est que beaucoup de ces lieux vivent ou revivent grâce au maintien et à la relance des pèlerinages et des fêtes locales.
Source : Chapelles de Provence - Serge Panarotto - Édisud. Photos du site Provence à vivre

